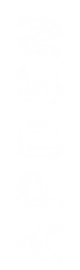Médias en crise, journalisme en réinvention.
Loïc BALLARINI - Mediadoc n°19.
Loïc Ballarini - Enseignant-chercheur en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Lorraine [1]
Fake news, éloignement du terrain, utilisation sans précaution de sondages à la fiabilité rarement discutée, concentration aux mains de quelques milliardaires plus préoccupés par les cours de la Bourse que par l’intérêt général et n’hésitant pas à recourir à la censure… La liste est longue des maux qui affecteraient les médias et qui, régulièrement, reviennent sur le devant de la scène pour caractériser la crise profonde qui les affecte. À tel point que les Dictionnaires d’Oxford, édités par la prestigieuse université britannique, ont choisi comme mot de l’année 2016 le terme post-truth, qui désigne cette ère de « post-vérité » dans laquelle nous serions entrés de plain-pied avec les campagnes électorales aboutissant, de notre côté de l’Atlantique, à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne, et de l’autre, à l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis d’Amérique. Certes, le mensonge n’est pas nouveau en politique, ni les promesses extravagantes. Mais quand l’émotion surmultipliée, la rumeur sciemment entretenue et la manipulation démagogique écrasent à ce point la matérialité des faits et l’argumentation rationnelle, le concept de vérité aurait perdu toute valeur dans le débat public.
Dans ce tableau noir, les médias joueraient un rôle d’amplificateur. En relayant – et parfois en construisant de toutes pièces – les rumeurs et les mensonges, en restant enfermés dans une vision étriquée du monde qui les a notamment empêchés de voir le ressentiment d’une partie des électeurs étatsuniens, en n’appliquant pas à eux-mêmes la morale qu’ils administrent aux autres, en étant plus attentifs aux bruissements des réseaux socionumériques qu’aux transformations de la société, en laissant se déverser au pied de leurs articles des commentaires devenus torrents d’immondices, ils creuseraient, moins lentement que sûrement, la tombe de l’information. Difficile toutefois de se satisfaire de ce constat. D’abord parce qu’il est, en bien des aspects, discutable et confus [2]. Ensuite parce qu’il mêle des champs sociaux, et donc des pratiques et des responsabilités qui, pour être liées, n’en obéissent pas moins à des logiques spécifiques. Les stratégies et recompositions politiques, les intérêts économiques, les mutations des communications et des pratiques culturelles exercent des influences de diverses natures sur les médias, qui se doivent dans le même temps d’en rendre compte selon des critères propres de déontologie et de professionnalisme. On ne peut pas rabattre les uns sur les autres, pas plus qu’il n’est raisonnable de réduire les médias aux turpitudes de quelques journalistes vedettes ou aux intrigues de certains de leurs dirigeants. Pour tenter de comprendre les transformations contemporaines du journalisme et des manières de traiter l’actualité, il est nécessaire de prendre un peu de recul historique, et d’identifier quelques facteurs décisifs [3].
Recompositions et concentration
À première vue, le secteur des médias demeure très diversifié en France : plus de 4 000 titres de presse, principalement des magazines, sont disponibles en kiosque ou sur abonnement ; près de 900 radios sont autorisées sur la bande FM ; et 27 chaînes de télévision sont accessibles à tou.te.s en diffusion numérique terrestre, des centaines d’autres l’étant via les box internet, le câble ou le satellite. Cependant ce paysage est très concentré, au rythme d’achats, fusions et plans sociaux qui se sont accélérés ces dernières années. Ainsi, l’essentiel de la diffusion des grands médias nationaux est désormais aux mains d’une dizaine de milliardaires [4]. Les cas de Serge Dassault, avionneur, homme politique et propriétaire du Figaro, ainsi que de Martin Bouygues, entrepreneur du BTP et propriétaire de TF1, sont bien connus et illustrent l’ancienne dépendance des médias français à des secteurs industriels liés en grande partie aux commandes publiques. Plus récemment, d’autres acteurs, venus d’autres sphères économiques, ont pris un poids important dans les médias. Bernard Arnault, première fortune de France, qui possède entre autres LVMH, Sephora et Givenchy, est également propriétaire du Parisien/Aujourd’hui en France, des Échos et de Radio Classique. François Pinault, septième fortune de France (Yves Saint-Laurent, Puma, Stade Rennais…), est le propriétaire du Point et du groupe L’Agefi. Patrick Drahi, huitième fortune de France, à la tête de plusieurs câblo-opérateurs (Altice : SFR, Cablevision), possède Libération, L’Express, BFM, RMC, SFR Sport, etc. Quant à Vincent Bolloré, douzième fortune de France, présent aussi bien dans les plantations, la logistique, le transport d’énergie et la communication (Havas, Dailymotion, Universal), il a récemment fait une entrée fracassante dans les médias en reprenant en main le groupe Canal+, renouvelant dirigeants et animateurs, programmes et lignes éditoriales, ce qui provoqua à l’automne 2016 une grève historique à iTélé (aujourd’hui CNews) à la suite de laquelle près d’une centaine de journalistes quittèrent la chaîne (sur 120 au total).
Le bouleversement des modèles économiques
Ces restructurations se font dans un contexte de mutation des audiences. Dans l’audiovisuel, le lancement de la TNT en 2005 a permis l’arrivée de nouvelles chaînes en accès gratuit qui, en 2016, représentent 29,3 % de l’audience — une part que les chaînes historiques ont donc perdue. La télévision, qui a su s’adapter aux nouvelles pratiques en développant le visionnage en différé et les interactions avec les réseaux socionumériques, reste le premier loisir des Français, avec une durée d’écoute moyenne de 3h43 par jour en 2016. Mais elle perd désormais du terrain chez les plus jeunes, qui la regardent un peu moins chaque année (2h19 par jour pour les 15-34 ans, contre 5h07 pour les plus de 50 ans) [5].
La presse, elle, dévisse. En moins de dix ans, la diffusion des journaux imprimés a perdu près de 40 %, et le chiffre d’affaires du secteur près de 30 %. La baisse de la diffusion a été compensée en partie par l’augmentation des tarifs de vente, mais les revenus de la publicité ont, sur la même période, diminué de près de la moitié [6]. De ce point de vue, la révolution Internet n’a pas eu lieu : l’espoir qu’un accès gratuit à l’information sur le web serait rendu possible par une nouvelle manne publicitaire suscitée par des audiences démultipliées a fait place à la déception devant le manque de résultat, puis au doute quant aux solutions à apporter. Entre le constat d’échec du modèle gratuit de Rue89 et le spectaculaire succès de l’accès exclusif sur abonnement de Mediapart, chaque média cherche aujourd’hui sa formule, entre retour en tout ou partie au payant, diversification dans la formation ou l’événementiel, recherche d’autres supports de diffusion, et les formes de publicité plus ou moins déguisées que constituent le brand content et le native advertising [7]. Seule certitude : aucune recette ne garantit aujourd’hui la rentabilité économique à moyen terme. Chacun doit au contraire trouver un mélange particulier de ces ingrédients parfois difficiles à accommoder que sont la ligne éditoriale, le public visé, les canaux de diffusion, les ressources nécessaires et les diverses sources de revenus.
Les difficultés économiques des médias ont des conséquences sociales directes. Alors qu’en France, le nombre de journalistes n’avait cessé d’augmenter depuis la fin du XIXe siècle, il baisse régulièrement depuis 2009. En 2016, 35 238 journalistes étaient titulaires de la carte de presse, contre 37 531 sept ans plus tôt [8]. Cette carte professionnelle, attribuée et renouvelée chaque année par une commission paritaire où siègent représentants des journalistes et des employeurs, atteste que son porteur exerce une activité de journaliste reconnue, et que celle-ci constitue son activité principale, régulière et rétribuée. La statistique ne tient donc pas compte du nombre croissant de ceux qui ne parviennent pas à obtenir la carte, notamment à cause de revenus insuffisants [9]. Or la précarité des journalistes augmente à mesure que leurs salaires moyens baissent. L’examen des premières demandes est évocateur. Alors qu’elle devrait marquer l’entrée dans la carrière, l’obtention d’une première carte de presse est devenue le signe d’une certaine stabilisation après plusieurs années de galère. Elle ne se fait plus que pour un tiers en CDI, et pour deux tiers comme pigiste [10] ou CDD — une proportion inversée par rapport à 2000. Enfin, les carrières des journalistes sont courtes, quinze ans en moyenne, entrecoupées ou interrompues définitivement par d’autres activités plus stables, notamment dans la communication [11].
À la recherche de nouvelles écritures
Pourtant, l’information n’a jamais été si abondante, ni son accès si facile. Certes, les kiosques continuent de fermer à un rythme qui compromet la diffusion, déjà difficile, de la presse papier. Mais l’information qui circule le plus est en ligne. Et mobile : les smartphones, qui fêtent à peine leurs dix ans, équipent déjà deux tiers des Français de plus de douze ans et constituent désormais le principal moyen d’accès à l’Internet… et à l’information. Pour beaucoup, il s’agit cependant d’une information low cost, vite (re)produite à partir de dépêches d’agence ou de copier-coller entre sites, et privilégiant la superficialité, le divertissement et le potentiel de viralité sur les réseaux socionumériques. Si le business peut être juteux pour les « pièges à clic » qui dominent le marché (Melty, MinuteBuzz, Konbini…), de nombreux sites réputés plus sérieux y recourent également. Un appauvrissement de plus pour une information déjà accusée depuis longtemps, et parfois avec raison, de manquer de rigueur et d’originalité, de céder trop facilement aux sirènes des stéréotypes, des petites phrases et des marronniers sans intérêt, mais aussi de défendre les intérêts d’une classe dominante dont les journalistes sont bien souvent issus, de se laisser aller à être faible avec les puissants et fort avec les faibles quand l’éthique commanderait plutôt de tenir tête aux premiers et de développer de l’empathie pour les seconds.
Tous ne se résignent cependant pas à se soumettre au régime de vérité des algorithmes au fonctionnement très opaque des plateformes qui, comme Google et Facebook, sont devenues les premières voies d’accès à l’information pour les internautes. Tenter d’y échapper complètement paraît illusoire – même les médias les plus alternatifs ont leur page Facebook et leur compte Twitter. Mais, des accommodements raisonnables aux tentatives de jouer avec les codes du moment, le répertoire d’actions est large. Le grand écart est même possible au sein du même média. Ainsi du Monde qui, tout en continuant sa publication papier, développe un éventail de propositions adaptées au web, allant d’une présence classique sur les réseaux socionumériques (promotion des articles) à une rédaction dédiée à Snapchat, où le sérieux du quotidien est passé aux filtres ludiques de l’application.
Parmi les pure players de l’information, ces médias qui n’existent qu’en ligne et se développent depuis une dizaine d’années, certains ont, beaucoup plus récemment, fait le choix d’une présence exclusive sur les réseaux socionumériques. Aux États-Unis, NowThis et AJ+ ont montré la voie en 2012 et 2014. En France, MinuteBuzz a franchi le pas en octobre 2016 : après six ans de publications sur son site, le média l’a abandonné pour ne plus diffuser que sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et YouTube. Un choix logique pour des contenus de divertissement qui font la part belle à la vidéo et cherchent avant tout la viralité. Un choix qui peut également être celui de médias d’information, comme Brut et Explicite, lancés quelques mois plus tard. Au menu de ces médias décidés à aller chercher l’audience là où elle se trouve : de courtes vidéos sous-titrées pouvant être vues sans le son, un ton décalé adapté à une cible jeune, des contenus souvent percutants, parfois engagés ou dénonciateurs. Mais aussi des contenus plus longs et diffusés en direct (débats, reportages, interviews).
À l’opposé de ce spectre, des médias font le pari que l’audience viendra à eux, attirée par l’originalité de leurs contenus – et, le plus souvent, prête à payer un abonnement pour y accéder. C’est le cas de Brief.me, une lettre d’information proposant chaque jour un résumé de l’actualité à la sortie du travail ; ou du Quatre Heures, qui diffuse un long format par mois, reportage enrichi de photos, sons ou vidéos. C’est encore celui des Jours qui, à coups d’« obsessions » pouvant compter plusieurs dizaines d’articles parfois répartis en saisons, s’inspire à la fois de la longue tradition du journalisme littéraire et du modèle des séries télévisées. Leur première « obsession », Les Revenants, que le journaliste David Thomson a consacrée au retour au pays des djihadistes français, a été couronnée par le Prix Albert-Londres 2017. C’était la première fois que la plus prestigieuse récompense du journalisme en France était attribuée à une production diffusée d’abord sur le web – même si le prix distinguait sa reprise en un livre.
La presse papier connaît également son lot d’innovations. Lancée en 2008 avec un succès qui ne s’est pas démenti depuis, la revue XXI a consacré le retour des formes narratives longues dans le journalisme et popularisé la formule des mooks, ces hybrides de magazine et de livre caractérisés par d’importantes livraisons (autour de 200 pages) en général trimestrielles. Parmi les initiatives qui ont suivi cette voie, citons la revue Desports, dédiée au sport, Schnock, à la culture populaire des Trente Glorieuses, ou La Revue Dessinée, au reportage en bande dessinée. Sur des rythmes de parution plus fréquents (et des paginations moins imposantes), Le 1 traite chaque semaine depuis 2014 une question d’actualité sous plusieurs angles (dont la poésie) et Society renouvelle, tous les quinze jours depuis 2015, le modèle du newsmagazine.
En région, il semble aussi difficile de maintenir un pure player qu’un magazine en dehors des groupes de presse quotidienne régionale. Le Mensuel du Morbihan, lancé en 2004 par des étudiants en journalisme à l’origine également du Mensuel de Rennes en 2009, a ainsi été racheté par Le Télégramme en 2015. Né et toujours édité en Picardie, Fakir est passé à une diffusion nationale en 2009. En Provence-Alpes-Côtes-d’Azur, Le Ravi reste fragile, et le site Marsactu, racheté par ses salariés après la faillite de sa société éditrice, a depuis adopté un modèle sur abonnement. Pour dépasser les limites d’un financement uniquement local tout en se donnant les moyens d’enquêter sur les grandes villes, le pure player sur abonnement Médiacités a été lancé à Lille fin 2016, avant d’ouvrir des éditions à Lyon, Nantes et Toulouse.
Points communs de ces expériences ? Tous ces médias, dont les quelques exemples cités ici ne constituent pas une liste exhaustive, mais qui se veut caractéristique, offrent à leurs lecteurs une ligne éditoriale forte et clairement identifiable. Manière de se distinguer dans un environnement très concurrentiel, d’y créer une « niche » dans laquelle le seuil de rentabilité ne soit pas démesuré. Manière aussi de proposer un contrat de lecture transparent, souvent fondé sur une thématique ou un format d’écriture permettant de fédérer une communauté de lecteurs appelée à se sentir partie prenante d’une aventure singulière.
La collaboration renouvelée ?
Car ce qu’il manque aux médias, c’est, de plus en plus, la confiance de leur public. Le baromètre annuel de La Croix en atteste : en trente ans de mesures, l’affirmation « Vous diriez que les choses se sont passées comme les médias les racontent » n’a que très rarement dépassé les 60 % d’appréciations positives pour la radio, le média le plus « crédible » – presse écrite et télévision se situant entre 10 et 20 % en dessous. Une des raisons les plus importantes est que les répondants estiment, à une large majorité, que les journalistes sont dépendants du pouvoir et des pressions de l’argent. Reporters sans frontières aboutit à la même conclusion, qui donne à la France la 39e place sur les 180 pays de son Classement mondial pour la liberté de la presse 2017. Une défiance qui trouve une traduction très concrète dans les violences dont les journalistes sont de plus en plus souvent la cible : physiques de la part de manifestants mais aussi des forces de l’ordre, verbales de la part des politiques en campagne, judiciaires de la part d’entreprises utilisant les procès en diffamation comme méthode de censure.
On ne s’étonnera donc pas que nombre de nouveaux médias mettent en avant, outre leur originalité éditoriale, leur attachement à l’éthique journalistique, leur refus de la publicité pour privilégier les abonnements, et l’implication des lecteurs dans la vie de la structure. Le recours au financement participatif est significatif de cette recherche de liens particuliers. Devenu très fréquent pour la constitution d’une base d’abonnés au moment du lancement ou de la reprise d’un titre, il est aussi utilisé pour ouvrir le capital du média aux lecteurs afin d’assurer son indépendance (Les Jours). Le choix d’une structure coopérative (SCIC pour Nice-Matin repris par ses salariés grâce à une campagne de financement participatif), associative (Le Ravi, Fakir) ou du nouveau statut d’Entreprise solidaire de presse d’information (Les Jours) peut venir renforcer la mise en actes de la conviction qu’un média n’est indépendant que s’il ne dépend (financièrement) que de ses lecteurs.
Engagés dans la défense d’une cause à laquelle ils veulent assurer la plus grande visibilité possible, certains médias font le choix de l’accès gratuit sans publicité : le soutien financier des lecteurs et/ou de fondations est alors d’autant plus déterminant (Bastamag, Orient XXI). Très délicate éditorialement parlant, la production de contenus journalistiques de qualité dans un cadre d’accès gratuit financé par la publicité n’est pas impossible, comme en témoigne Buzzfeed, étonnant mix de divertissement et d’information sérieuse en prise avec des thématiques sociales (migrants, racisme, sexisme).
Les liens entre journalistes et public ne sont pas uniquement financiers. La confiance se (re)gagne aussi en organisant des rencontres avec les lecteurs, en ouvrant les conférences de rédaction, ou plus prosaïquement en intégrant questions et remarques dans les productions, notamment lors de la couverture d’événements en direct qui, avec les discussions sur les réseaux socionumériques, permettent au moins un semblant d’interactivité. Quand la confiance est là et l’entreprise rentable, on assiste à la création de groupes de presse indépendants, comme So Press (Society, SoFoot, SoFilm…), parfois liés à des maisons d’édition : Rollin publications, qui édite XXI, 6 mois et lancera Ebdo en 2018, appartient au même groupe que les éditions des Arènes et L’Iconoclaste, quand les éditions du Sous-sol sont également éditrices de Feuilleton et de Desports.
La collaboration a également lieu entre journalistes. Sur le terrain, les usages de la confraternité n’ont jamais disparu, consistant à dépanner un.e collègue ou à partager informations et contacts entre journalistes. Mais ensuite, la concurrence entre médias reprend ses droits. Dans le contexte de la globalisation des échanges (et des affaires), il est cependant apparu pertinent de développer des coopérations transnationales entre médias qui peuvent occuper la même position sur leur marché intérieur. Là où il aurait été inimaginable que Le Monde enquête conjointement avec Le Figaro sur le même dossier, il fut au contraire fructueux que la Süddeutsche Zeitung, destinataire de documents recueillis par un lanceur d’alerte, les partage avec 109 rédactions réparties dans 76 pays. Sous l’égide de l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), près de 400 journalistes ont ainsi travaillé pendant un an à partir des données du cabinet d’avocats Mossack Fonseca, aboutissant en mars 2016 à la publication des Panama Papers, documentant des pratiques d’évasion fiscale à grande échelle et provoquant une onde de choc mondiale. Inutile de préciser que les moyens modernes de sécurisation des documents et des communications jouent ici un rôle essentiel, permettant aux médias participants d’élaborer ensemble une vision globale, tout en travaillant sur les dossiers concernant leurs pays (en France : Le Monde et Premières lignes pour l’émission Cash Investigation). L’ICIJ existe depuis 1997 et a déjà conduit plusieurs opérations de ce type, la dernière en date étant les Paradise Papers, publiés en novembre 2017. Plus récent, le réseau European Investigative Collaborations (EIC) a été fondé en 2016 à l’initiative de Der Spiegel et du Centre roumain pour le journalisme d’investigation, Mediapart en étant le membre français. L’EIC a notamment sorti l’affaire des Football Leaks en 2017.
Beaucoup moins visibles, et parfois beaucoup moins formels, existent des échanges entre journalistes nourris notamment de l’esprit des communautés du logiciel libre. Listes et groupes de partage de pratiques, de savoir-faire, voire de code informatique (Newsresources, Bac à sable et boîte à outils du Temps), ainsi que groupements de formation professionnelle (Médiacadémie, Ouest Medialab) innervent le petit monde des journalistes, développeurs, graphistes et éditeurs qui font ces nouveaux médias et ces nouveaux formats (webdocumentaires, longs formats, datavisualisation, infographie interactive, newsgame…). Les médias sont en crise ? Le journalisme, lui, ne l’est pas. Grâce à une éthique forte lui permettant de conserver des frontières ouvertes, le groupe professionnel se structure autour du partage de fondamentaux, déclinés en valeurs, méthodes et principes de travail à la fois stables dans le temps et adaptables aux nouvelles configurations d’exercice de la profession. Le journalisme ne cesse ainsi de se réinventer, puisant dans les mutations techniques et sociales de son temps le carburant de la légitimation d’un rôle social essentiel. Celui d’être un des piliers des sociétés démocratiques, en mettant à la hauteur de tou.te.s la complexité du monde et en nourrissant le débat sur les enjeux collectifs. Un débat auquel l’école peut contribuer à préparer les élèves, en leur permettant d’analyser les rôles, contraintes et responsabilités des différents acteurs, en particulier les journalistes et les médias.
Exemples de séquences pédagogiques
**Pour le collège :
![]() Bretton Christine. Nallathamby Marie. Reynaud Florian. Désinformation : de la médiatisation à l’éthique de l’information. In SavoirsCDI [en ligne], 2014. Disponible sur : http://www.cndp.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/apprentissage-et-construction-des-savoirs/leducation-aux-medias-et-a-linformation/desinformation-de-la-mediatisation-a-lethique-de-linformation.html. Consulté le 01.11.2017
Bretton Christine. Nallathamby Marie. Reynaud Florian. Désinformation : de la médiatisation à l’éthique de l’information. In SavoirsCDI [en ligne], 2014. Disponible sur : http://www.cndp.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/apprentissage-et-construction-des-savoirs/leducation-aux-medias-et-a-linformation/desinformation-de-la-mediatisation-a-lethique-de-linformation.html. Consulté le 01.11.2017
![]() Mulot Hélène. Les émetteurs d’information en ligne (ou la notion de source à partir de Google Actualité). In L’odyssée d’Ln : je tisse m@ Toile [en ligne], 2012. Disponible sur : http://odysseedln.overblog.com/les-emetteurs-d-information-en-ligne-ou-la-notion-de-source-a-partir-de-google-actualite. Consulté le 01.11.2017
Mulot Hélène. Les émetteurs d’information en ligne (ou la notion de source à partir de Google Actualité). In L’odyssée d’Ln : je tisse m@ Toile [en ligne], 2012. Disponible sur : http://odysseedln.overblog.com/les-emetteurs-d-information-en-ligne-ou-la-notion-de-source-a-partir-de-google-actualite. Consulté le 01.11.2017
**Pour le lycée :
![]() Cattet Christine. Lacrosse Cécile. Ouvrard Laurence. Mettre en scène l’information pour mieux la comprendre. In Doc TICE. Site des documentalistes de l’académie de Besançon [en ligne], 2014. Disponible sur : http://documentation.ac-besancon.fr/sequence-pedagogique-mettre-en-scene-linformation-pour-mieux-la-comprendre/. Consulté le 01.11.2017
Cattet Christine. Lacrosse Cécile. Ouvrard Laurence. Mettre en scène l’information pour mieux la comprendre. In Doc TICE. Site des documentalistes de l’académie de Besançon [en ligne], 2014. Disponible sur : http://documentation.ac-besancon.fr/sequence-pedagogique-mettre-en-scene-linformation-pour-mieux-la-comprendre/. Consulté le 01.11.2017
![]() Garnier Eric. EPI : La désinformation par l’image [séquence conçue par Kadima Kadi]. In Documentation. Académie de Rouen [en ligne], 2017. Disponible sur : http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article903. Consulté le 01.11.2017
Garnier Eric. EPI : La désinformation par l’image [séquence conçue par Kadima Kadi]. In Documentation. Académie de Rouen [en ligne], 2017. Disponible sur : http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article903. Consulté le 01.11.2017
Notes
[1] Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, coresponsable du Master Journalisme et médias numériques (Metz), chercheur au Centre de recherche sur les médiations (Crem). Carnet de recherches : http://ballarini.fr/loic. La bibliographie de cet article, augmentée de références complémentaires, peut être retrouvée sur http://ballarini.fr/loic/?p=693.
[2] À commencer par le terme de post-vérité, qui ne saurait à lui seul résumer une époque. On peut d’ailleurs relativiser l’importance du « mot de l’année » en se souvenant que les précédents étaient… l’émoticône « visage avec des larmes de joie » (2015), vapoter (2014) et selfie (2013). Sur le versant journalistique du problème, lire la synthèse de la regrettée Louise Merzeau : « Les fake news, miroir grossissant de luttes d’influences », Ina Global, mis en ligne le 19/05/2017, http://www.inaglobal.fr/idees/article/les-fake-news-miroir-grossissant-de-luttes-d-influences-9713
[3] Au-delà des limites de cette contribution, un panorama de ces questions est disponible dans le très riche dossier dirigé par Béatrice Fleury et Jacques Walter : « État des recherches en SIC sur l’information médiatique », Revue française des sciences de l’information et de la communication, nº5, 2014, https://rfsic.revues.org/992.
[4] Pour une vision synthétique, voir l’infographie « Médias français : qui possède quoi », régulièrement mise à jour par Le Monde Diplomatique, http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ppa
[5] Source Médiamétrie, Médiamat annuel 2016.
[6] Entre 2008 et 2014 (derniers chiffres disponibles), baisse de 39,16 % de la diffusion des journaux (nombre d’exemplaires effectivement distribués, à distinguer du tirage, qui est le nombre d’exemplaires imprimés et suit une évolution parallèle). Entre 2008 et 2015 (derniers chiffres disponibles), baisse de 28,16 % du chiffre d’affaire de la presse. Les recettes de ventes baissent de 12,98 %, celles venant de la publicité de 47,74 %. Ces chiffres concernent l’ensemble de la presse, gratuite et payante. Source : ministère de la Culture et de la communication, http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Presse/Chiffres-statistiques
[7] Le brand content (« contenu de marque ») désigne un contenu éditorial (vidéo, article, hors-série…) produit par une marque sur un support web, papier ou audiovisuel. Le native advertising (« publicité native ») désigne une publicité prenant la forme des contenus habituels d’un site web, et se rapproche de la pratique ancienne du publi-reportage.
[8] Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels. 35238 cartes attribuées en 2016. [en ligne] Disponible sur http://ccijp.net/article-33-cartes-attribuees-en.html (consulté le 22 octobre 2017)
[9] Un des critères d’attribution de la carte (l’activité principale) implique que plus de la moitié des revenus annuels de la personne proviennent du journalisme. Aucun titre particulier n’étant exigé pour exercer, on peut cependant avoir une activité de journaliste qui ne constitue pas le principal de ses revenus. La carte de presse apporte reconnaissance, légitimité et facilite l’exercice de la profession, mais elle n’est ni un prérequis ni une nécessité.
[10] Le journaliste indépendant est nommé pigiste, une pige étant une production commandée par un média. Bien que sans contrat de travail, il jouit selon la loi des mêmes droits que le salarié (rémunération en salaire, droit à la formation et aux indemnités de chômage en cas de licenciement…).
[11] Christine Leteinturier, dir., Les Journalistes français et leur environnement : 1990-2012. Le cas de la presse d’information générale et politique, Paris, Éd. Panthéon-Assas, 2014, 240 pages ; IFP/Carism, L’Insertion et les parcours professionnels des diplômés de formations en journalisme, 2017, 146 pages, en ligne : https://metiers-presse.org/insertion-parcours-journalistes/